
- Cet évènement est passé.
Les choses des lointains : artefacts, échantillons et spécimens, des colonies jusqu’en métropole (16e-18e siècles)
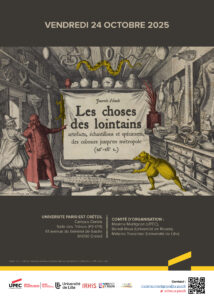 L’histoire de la « découverte » du monde par les Européens fait la part belle au récit de la nouveauté : nouveaux espaces, nouvelles populations, nouvelles natures s’offrent aux yeux des explorateurs, conquérants, missionnaires ou savants. Saisis par ces nouveautés du bout du monde, désireux de les faire connaître chez eux et d’accréditer leurs récits par leur moyen, ces acteurs rapportent des choses naturalisées ou artificielles amorçant ainsi l’histoire d’une expansion coloniale des empires européens. La valorisation de ces nouveautés va de pair avec celle de leurs « découvreurs », voyageurs ou promoteurs dont le nom propre a parfois fini par désigner la chose collectée, tandis que les choses mêmes sont assignées à des noms de populations incertains ou à des catégories étrangères aux sociétés qui les ont produites telles les « haches-ostensoirs » kanak qui ne sont ni des haches, ni des ostensoirs. L’ambition de cette journée d’études, organisée par Maxime Martignon (CRHEC, UPEC), Benoît Roux (ERIAC, Université de Rouen Normandie) & Mélanie Traversier (IRHiS, Université de Lille), est ainsi d’affronter la construction historique des discours européens sur les choses d’ailleurs, sur le vivant devenu spécimen exotique, sur les objets des autres devenus – pour partie au moins – nôtres, tout en l’articulant à leurs différents usages métropolitains dans le cadre des circulations impériales et coloniales propres à l’époque moderne.
L’histoire de la « découverte » du monde par les Européens fait la part belle au récit de la nouveauté : nouveaux espaces, nouvelles populations, nouvelles natures s’offrent aux yeux des explorateurs, conquérants, missionnaires ou savants. Saisis par ces nouveautés du bout du monde, désireux de les faire connaître chez eux et d’accréditer leurs récits par leur moyen, ces acteurs rapportent des choses naturalisées ou artificielles amorçant ainsi l’histoire d’une expansion coloniale des empires européens. La valorisation de ces nouveautés va de pair avec celle de leurs « découvreurs », voyageurs ou promoteurs dont le nom propre a parfois fini par désigner la chose collectée, tandis que les choses mêmes sont assignées à des noms de populations incertains ou à des catégories étrangères aux sociétés qui les ont produites telles les « haches-ostensoirs » kanak qui ne sont ni des haches, ni des ostensoirs. L’ambition de cette journée d’études, organisée par Maxime Martignon (CRHEC, UPEC), Benoît Roux (ERIAC, Université de Rouen Normandie) & Mélanie Traversier (IRHiS, Université de Lille), est ainsi d’affronter la construction historique des discours européens sur les choses d’ailleurs, sur le vivant devenu spécimen exotique, sur les objets des autres devenus – pour partie au moins – nôtres, tout en l’articulant à leurs différents usages métropolitains dans le cadre des circulations impériales et coloniales propres à l’époque moderne.
Programme
9h10 — Accueil
9h35 — Présentation de la journée par la direction CRHEC
9h40 — Introduction. Maxime Martignon (CRHEC, UPEC), Benoît Roux (ERIAC, Université de Rouen Normandie) & Mélanie Traversier (IRHiS, Université de Lille)
Session 1 : Décrire, nommer, mettre en récits les choses
Présidence : André Delpuech (Centre Alexandre Koyré)
10h00 — Maxime Martignon (CRHEC, UPEC) & Benoît Roux (ERIAC, Université de Rouen Normandie), « Un balai de France n’est pas un ornement mais un balai d’El Dorado porté en France pourra en être un ». Curiosité en miroir dans les lettres du père de la Mousse (Guyane années 1690)
10h30 — Discussion
10h40 — Pause
10h50 — Noémie Etienne (Universität Wien), De quoi « exotique » est-il le nom ? Étudier, exposer, et nommer les collections
11h20 — Claire Brizon (Lausanne, Musée cantonal d’archéologie et d’histoire), Questionner les dénominations des objets extra-européens conservés dans les collections muséales occidentales
11h50 — Discussion
12h15 — Repas
Session 2 : Collecter, acclimater, valoriser les choses
Présidence : Marie-Karine Schaub (UPEC)
13h45 — Laurent Brassart (IRHiS, Université de Lille), De l’arachide et des chênes américains dans la France napoléonienne ou comment le projet d’une machine botanique d’État déraille
14h15 — Mathilde Chollet (LARHRA, Lycée Condorcet de Saint-Priest), Les choses de Saint-Domingue, outils au service de l’ambition familiale pour les Edme des Rouaudières en métropole (2e moitié du XVIIIe siècle)
14h45 — Discussion
15h05 — Héloïse Hermant (Pléiades, Sorbonne Paris-Nord), Circulations, qualifications et classifications des choses du lointain : Pedro Franco Davila et le Real Gabinete de Historia Natural (1767-1786)
15h35 — Discussion
15h45 — Pause
Conférence finale
introduite par Mélanie Traversier (IRHiS, Université de Lille)
16h00 — Nicholas Thomas (Cambridge University, Museum of Archaeology and Anthropology), Collected, lost, rediscovered, returned: The artefacts of the Endeavour voyage
 L’ERIAC sur HAL
L’ERIAC sur HAL